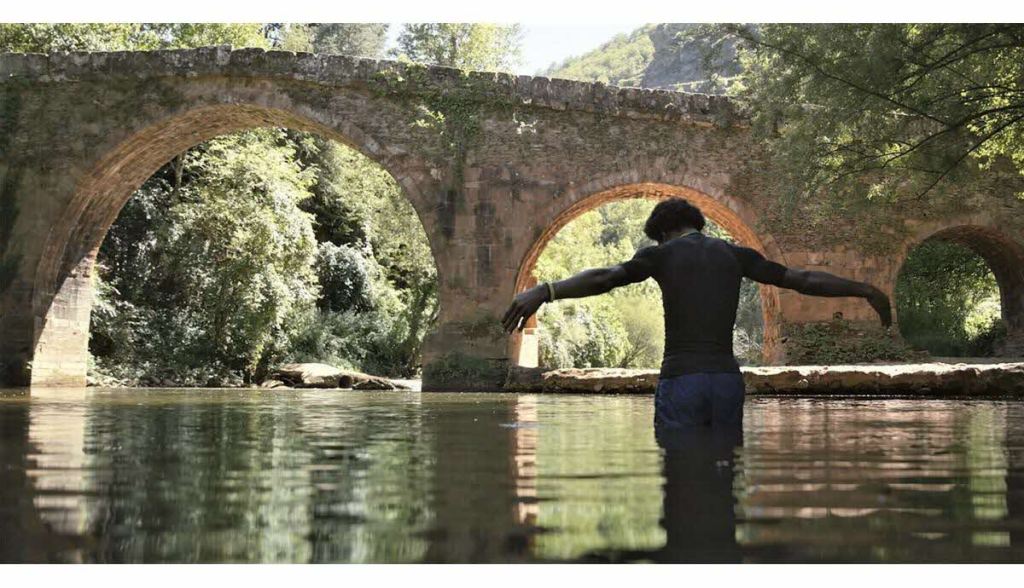C’était pas foufou hein.
Sympa, rigolo parfois, plutôt sobre et élégant dans la lumière et la photo mais pas tant plus. On s’attend parfois à ce que certains sujets abordés soient plus déroulés, les traumas des uns ou la résolution de l’intrigue par un autre, mais non. C’est léger, mais ça suffit pas. Pendant tout le film, je me rappelais, peut-être à tort, les téléfilms de Catherine Frot et André Dissocier. Je suis certain que la réalisatrice me tuerait pour cette comparaison.
Cela dit, on assiste à la présence de trois acteurs majeurs du cinéma français et international.
Je connais mal Jodie Foster, c’est une icône c’est vrai. Enfant érotisée avec Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), enquêtrice terrifiée mais pugnace dans Le silence des agneaux (Jonathan Demme, 1991) ou gardienne de l’équilibre des classes dans Elysium (Neill Blomkamp, 2013). Voilà le peu que je connaissais de Jodie Foster. Faudra un jour définir comment on devient culte.
Jodie Foster, que je savais trilingue, est vraiment efficace dans son jeu en français, on ajoute un peu de narration pour faire comprendre ses propos ou son accent anglais, mais ça ne gêne jamais et je la salue pour ça ! On aime voir sa grâce et son sourire, mais dans ce contexte ça s’arrête un peu là et la performance est plus technique que prenante.
Daniel Auteuil est gentillet, un peu drôle, un peu amoureux, toujours avec ce charme bourgeois de la réussite bedonnante des secondes parties de vie (ou de carrière).
Quant à MONSIEUR Mathieu Amalric, il nous sort une fois de plus un grand jeu d’acteur.
Je ne comprendrai jamais ma fascination pour le jeu de cet homme, ce regard de chien battu ou rageur, cette intonation de voix brisée, ce flegme caractéristique, un peu sale et authentique. Je me souviendrai toujours du monologue de la lettre à sa sœur dans Un conte de Noël (Arnaud Desplechin, 2008) qui m’avait frappé par la froideur de son jeu et de sa voix, posés, une scène presque lue sans jeu. Cet homme qui a su interpréter un méchant français dans un James Bond, peut-être le meilleur ? Celui qui nous a troublés par sa mélancolie, son mutisme et sa fragilité dans Le grand bain (Gilles Lellouche, 2018). Bref, ce grand acteur là.
Son personnage rôde, triste et enragé, avec toujours le mot juste qui trahit si bien la nature humaine. J’t’adore, même si j’ai dit Almaric pendant des années.
En définitive, le film est léger, parfois farceur avec le personnage de l’hypnotiseuse ou de certains patients. On se perd entre thriller, comédie, drame familial, et c’est un peu lent. Ce qui sauve le film, et ne semble pas commun, c’est la capacité qu’il a de rendre sa beauté à l’amour pas toujours glamour. Dans une époque où le corps est plus montré et façonné que dans l’Antiquité, on assiste là à une sensualité des corps qui ont passé la soixantaine. Les bisous pleins de rides, pleins de poils, et les corps pleins de relâchement, ça ne se montre pas beaucoup au cinéma. On ne filme pas l’amour digne des corps de nos parents, mais c’est vraiment beau.
Bref, cette chronique était laborieuse mais j’ai fait plus d’efforts que Beigbeder sur France Inter, alors si vous avez besoin d’un ghoswriter, vous avez mon numéro.